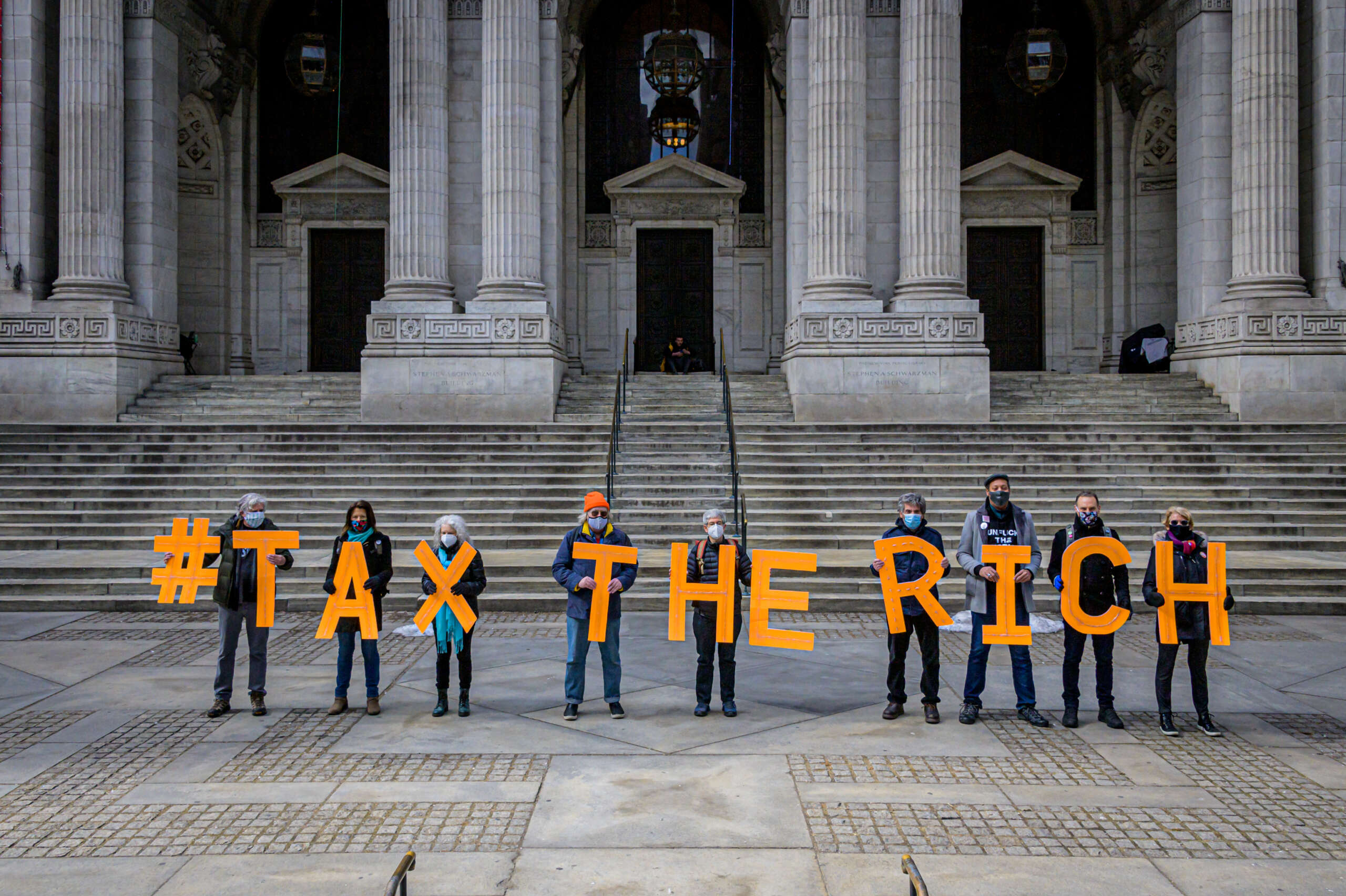La victoire historique de Zohran Mamdani pour la classe ouvrière dans la capitale financière mondiale est le reflet de l’attrait croissant de plateformes audacieuses qui s’attaquent aux inégalités extrêmes et à l’oligarchie et évoluent vers une société plus équitable et plus juste. Les inégalités constituent sans aucun doute l’un des plus grands problèmes sociaux auxquels sont confrontés de nombreux pays à travers le monde. L’écart entre les nantis et les démunis s’est creusé à des niveaux si extrêmes qu’il menace la stabilité sociale en sapant à la fois la gouvernance démocratique et la durabilité économique. Et comment pourrait-il en être autrement alors que les 1 pour cent les plus riches possèdent plus de richesses que 95 pour cent de l’humanité ? Aux États-Unis, pays où les disparités de richesse sont plus grandes que tous les autres grands pays développés, les 1 pour cent les plus riches détiennent environ 31 pour cent de la richesse totale du pays tandis que les 50 pour cent les plus riches possèdent 98 pour cent de la part totale de la richesse américaine.
À la lumière de ces données profondément inquiétantes, il n’est guère surprenant que les voix se multiplient pour réclamer la mise en œuvre de mesures visant à réduire les inégalités économiques. En France, la proposition fiscale dite Zucman est devenue le sujet le plus brûlant du pays, et bien que les législateurs de la chambre basse française viennent de rejeter plusieurs propositions visant à taxer les ultra-riches, la lutte n’est pas terminée. Aux États-Unis, un groupe de démocrates au Congrès a récemment introduit le Billionaires Income Tax Act, et des groupes du travail et de la santé en Californie ont proposé un impôt sur la fortune de 5 pour cent pour les milliardaires de l’État afin de compenser les milliards de dollars de coupes fédérales dans le financement des soins de santé. Comme preuve supplémentaire de l’intérêt politique suscité par la demande de taxer les ultra-riches, les législateurs de l’Illinois ont proposé une taxe unique de 4,95 pour cent sur les résidents qui détiennent des actifs papier d’une valeur nette supérieure à 1 milliard de dollars.
Quoi qu’il en soit, et en supposant que les propositions d’impôt sur la fortune soient politiquement viables et puissent résister aux défis que leur posent la classe dirigeante et les oligarques et leurs divers alliés, sont-elles suffisantes pour réduire les niveaux stupéfiants d’inégalité dans le monde d’aujourd’hui ou devons-nous abolir complètement l’extrême richesse ? De plus, que révèle la structure du système fiscal américain sur la guerre des classes et nous apprend-elle quelque chose sur la paralysie actuelle du gouvernement ? Nancy Folbre, économiste socialiste et féministe de renom, partage ses idées sur ces questions et d’autres questions cruciales sur les efforts politiques visant à taxer les plus riches et leurs ramifications économiques. Folbre est professeur émérite d’économie et directeur du programme sur le genre et le travail de soins à l’Institut de recherche en économie politique (PERI) de l’Université du Massachusetts à Amherst.
CJ Polychroniou : Partout dans le monde, les propositions visant à taxer les ultra-riches afin de lutter contre la montée des inégalités gagnent du terrain. En effet, de nombreuses options ont été proposées, allant de nouveaux impôts sur les revenus du capital et de taux d’imposition sur le revenu plus élevés jusqu’à un impôt mondial sur la fortune. Pourquoi taxer les ultra-riches est-il considéré comme d’une telle importance cruciale alors que les inégalités font partie du fondement des économies capitalistes ? Cela réduira-t-il réellement l’écart de richesse ?
Nancy Folbre : Je ne suis pas sûr que de telles propositions prennent de l’ampleur, mais elles génèrent certainement de la publicité et, ce faisant, sensibilisent à la concentration de plus en plus extrême des revenus et des richesses à tous les niveaux. Les inégalités mondiales sont particulièrement choquantes, et l’économiste Gabriel Zucman a expliqué comment les nations pourraient collectivement s’orienter vers un impôt mondial de 2 % sur la richesse des milliardaires. Le Brésil en a été l’un des principaux promoteurs et l’a présenté lors de réunions internationales. Compte tenu de la structure actuelle des institutions politiques mondiales, la faisabilité semble assez lointaine.
Un tel impôt sur la fortune pourrait-il réellement réduire les inégalités de richesse ? Probablement pas, même s’il est mis en œuvre au niveau national. Au mieux, cela pourrait ralentir la tendance que Thomas Piketty, entre autres, a documentée : la concentration croissante qui se produit lorsque la richesse croît plus vite que l’économie dans son ensemble – alors que les richesses engendrent les richesses.
On ne peut que se demander où et quand cette tendance prendra fin. La vision marxiste d’une baisse du taux de profit conduisant à une crise capitaliste a été remplacée par une vision plus dystopique d’une accumulation incessante et sans fin d’argent et de pouvoir. L’anxiété que cette vision suscite – et la menace qu’elle laisse présager pour la démocratie – explique pourquoi les mots « impôt sur la fortune » reviennent plus souvent sur les lèvres des politiciens que par le passé.
Cependant, l’inégalité elle-même semble moins une préoccupation politique que la difficulté de financer la reproduction sociale de la population dans une période d’inégalités et de divisions sociales croissantes – ou, dans un langage plus courant – de financer « l’État-providence ». Dans l’environnement politique actuel, les déficits importants et l’augmentation de la dette publique ne peuvent aller plus loin avant de se heurter à la nécessité d’augmenter les impôts ou de réduire les dépenses, et les électeurs de la classe ouvrière qui se sentent économiquement laissés pour compte sont furieux à l’idée qu’on leur demande de payer plus ou de se contenter de moins.
Que pensez-vous de la taxe dite Zucman qui fait grand bruit en France ? Il s’agit de prélever un impôt de 2 pour cent sur les ménages dont les revenus dépassent 100 millions d’euros. Mais supposons que cette proposition soit également mise en œuvre aux États-Unis et dans le monde entier. Un impôt de 2 % sur les ultra-riches est-il suffisant pour réduire les inégalités ?
Le large soutien du public en faveur d’un impôt sur la fortune de 2 % en France a été largement motivé par des préoccupations pratiques : utiliser les recettes qui en résulteraient pour éviter de réduire les dépenses sociales et les prestations de retraite. Un sondage de septembre a montré le soutien de 86 pour cent des personnes interrogées, en partie parce que la proposition était conçue pour affecter seulement environ 1 800 ménages. En d’autres termes, cela cible le groupe que vous avez décrit comme les « ultra-riches ».
Cela semble à peine suffisant pour réduire significativement les inégalités globales. On pourrait considérer cela comme une réduction d’environ 2 % de la haute flèche d’une grande cathédrale de la richesse. Pourtant, la proposition a une grande valeur symbolique, dramatisant les inégalités et soulevant des questions fondamentales sur l’équité – c’est exactement pourquoi elle se heurte à une résistance farouche.
Pouvez-vous discuter un peu de la nature de la structure globale de la fiscalité aux États-Unis et si, en particulier, elle reflète qui gagne la lutte des classes entre le capital et le travail ? Cela aide-t-il également à expliquer la fermeture du gouvernement ?
Aux États-Unis, l’attention se porte principalement sur l’impôt fédéral sur le revenu, parce qu’il constitue une source majeure de revenus, mais aussi parce que les Républicains ont toujours insisté pour réduire le taux d’imposition des revenus élevés. Les partisans conservateurs de l’économie de l’offre ont affirmé avec insistance que cela favoriserait la croissance économique et améliorerait la situation de tous. Aucune preuve ne soutient cette affirmation.
Les politiques qui imposent un taux d’imposition plus élevé aux personnes à revenus plus élevés sont qualifiées de « progressistes » et celles qui font le contraire de « régressives ». Les deux partis politiques sont de connivence dans des politiques qui n’ont cessé de réduire la progressivité depuis les années 1960. Le taux marginal d’imposition le plus élevé (le taux sur le revenu imposable de la tranche la plus élevée) est tombé d’environ 91 pour cent à environ 35 pour cent au début des années 2000. Depuis les années 1960 également, l’impôt sur le revenu des sociétés a diminué de moitié environ, alors même que les charges sociales augmentaient.
En 2006, le célèbre investisseur à succès Warren Buffet s’est en fait plaint du fait que sa secrétaire était confrontée à un taux d’imposition plus élevé sur ses revenus que sur l’augmentation de sa richesse, qui comprenait des gains en capital qui n’étaient absolument pas imposés. Comme il l’a dit : « Il y a bien une guerre de classes, mais c’est ma classe, la classe riche, qui fait la guerre, et nous gagnons. »
Notez qu’il s’agit là d’un type de lutte des classes très différent de celui pour les profits et les salaires au point de production. Il s’agit d’une lutte pour le salaire social, le paiement des prestations de santé, de retraite et de sécurité sociale qui sont fournis plus efficacement par l’État que par le secteur privé, des prestations qui ont été obtenues grâce à un processus de négociation politique démocratique.
Les employeurs ont des incitations économiques évidentes à s’opposer aux augmentations du salaire social s’ils sont obligés de les payer. Cependant, les dépenses sociales publiques peuvent leur permettre de maintenir les salaires à un niveau bas en transférant une partie des coûts de reproduction des travailleurs sur le public dans son ensemble. C’est pourquoi l’incidence de la fiscalité est vraiment importante. Les augmentations des salaires sociaux, comme l’expansion des prestations d’assurance maladie, ont partiellement compensé cinquante ans de stagnation des revenus corrigés de l’inflation de la majorité des salariés aux États-Unis. Ces dernières années, cependant, même cette compensation partielle a diminué et elle est actuellement directement attaquée.
L’administration Trump a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réduire les impôts des riches et les prestations sociales des familles à revenus faibles et moyens (voir cette analyse du soi-disant Big Beautiful Bill adopté l’été dernier). La fermeture actuelle du gouvernement américain est une confrontation, les démocrates étant réduits à des efforts plutôt désespérés pour simplement maintenir le cap en insistant sur le maintien des subventions aux soins de santé pour l’Affordable Care Act.
Les contribuables indignés qui croient payer plus que leur juste part invoquent l’impôt fédéral sur le revenu, qui est relativement progressif, en partie parce que de nombreux Américains ne gagnent même pas assez pour les payer. Mais l’impôt fédéral sur le revenu ne représente qu’environ la moitié des recettes fiscales totales, et plus de la moitié de l’impôt sur le revenu des sociétés est simplement répercuté sur les consommateurs sous la forme d’une hausse des prix. D’autres taxes, notamment les taxes nationales et locales sur les ventes et la propriété, sont régressives.
Ces impôts régressifs compensent largement les impôts progressifs sur le revenu, ce qui entraîne peu d’impact différentiel sur l’ensemble de la répartition des revenus. L’Institut de fiscalité et de politique économique rapporte qu’en 2024, les 1 % d’Américains les plus riches ont payé environ 23,9 % de tous les impôts, mais leur part du revenu imposable total était de 20,1 %. Cette estimation ne prend pas en compte les « plus-values latentes » (augmentations de la valeur de leur patrimoine). On estime que les 20 pour cent les plus pauvres de tous les Américains ne paient que 1,5 pour cent de leur revenu en impôts, mais leur part du revenu total n’était que de 2,6 pour cent. Beaucoup d’entre eux vivaient dans la pauvreté parce qu’ils élevaient des enfants ou prenaient soin de membres âgés de leur famille – des activités qui devraient être considérées comme une contribution à notre « reproduction sociale ».
C’est un peu compliqué, non ? La difficulté de déterminer qui paie réellement quoi explique sûrement pourquoi il est devenu difficile de défendre – et encore moins d’augmenter – le salaire social.
En Californie, le Service Employees International Union (SEIU) a proposé une initiative de vote visant à imposer une taxe unique de 5 pour cent aux milliardaires. Quels avantages la population californienne pourrait-elle tirer d’un impôt sur la fortune des quelque 200 milliardaires de l’État ?
Cette initiative syndicale fournit encore un autre exemple de lutte des classes sur la répartition des coûts de la reproduction sociale. La justification explicite de la proposition d’un impôt unique sur la fortune est de contrer la menace de coupes fédérales de 30 milliards de dollars dans le programme californien d’assurance maladie Medicaid pour les familles à faible revenu, ainsi que de fournir davantage de soutien à l’éducation publique dans l’État.
Cela résoudra-t-il les problèmes fiscaux de l’État ? Évidemment non. Mais c’est un pas dans la bonne direction, à l’instar de la politique que la ville de Los Angeles a mise en place en 2023, imposant un taux d’impôt foncier plus élevé sur les biens immobiliers de très grande valeur afin d’aider à financer des logements abordables – une « taxe foncière ».
Qu’en est-il de l’argument selon lequel les impôts sur la fortune pousseraient les super-riches à fuir ?
Oui, c’est toujours la réponse menacée, et certains très riches suivront probablement – en particulier ceux qui possèdent déjà plusieurs demeures à travers le monde. Mais de nombreuses personnes fortunées accordent suffisamment d’importance à leurs communautés locales pour y rester. Ici, dans le Massachusetts, où je vis, nous avons adopté un amendement de partage équitable à la constitution de notre État en 2022 pour autoriser une surtaxe de 4 % sur les revenus supérieurs à un million de dollars. Nous n’avons pas assisté à un exode significatif et nous utilisons les revenus pour aider à financer des collèges communautaires et à réparer les nids-de-poule. Je suis fier de dire que mon syndicat, la Massachusetts Society of Professors, a joué un rôle crucial dans l’obtention de cet amendement.